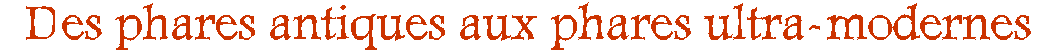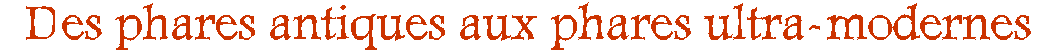|
On raconte dans la mythologie, que la belle Héro, qui habitait sur
la rive du Bosphore, était chaque nuit visitée par un jeune homme nommé
Léandre qui traversait le détroit à la nage. Il arriva, par une nuit
sans lune, que les vents éteignirent le flambeau et que Léandre, privé
de ce fanal sauveur, trouva la mort dans les remous du Bosphore. Héro
aurait été ainsi été, dans la nuit des temps, l’instigatrice des
phares.
Un peu plus tard, à
l’époque où les Phéniciens, commerçants et navigateurs, sillonnaient
en tous sens la Méditerranée, et venaient,
jusqu’en Provence, fonder Marseille, des feux de navigation
furent établis en de nombreux endroits pour signaler les points dangereux
et l’entrée des ports. Le Pirée, port d’Athènes, était pourvu,
plusieurs siècles avant l’ère chrétienne, de tours à feu qui
servaient à la fois de phares…et de bastions défensifs contre les
pirates !
|
|
Le « Phare
d’Alexandrie », merveille du monde.
Les phares de l’antiquité grecque et romaine étaient, en général,
fort primitifs : une simple tour cylindrique ou conique à plusieurs
étages portant à son sommet un foyer en maçonnerie dans lequel on brûlait
du bois. Le bois donne une lueur vive et claire, surtout si le foyer est
disposé de façon à procurer un bon tirage avec cheminée courte,
laissant passer la partie éclairante de la flamme ; la portée
obtenue peut donc être considérable, sans toutefois que ce service
rudimentaire puisse être comparé à nos phares modernes.
Une exception doit cependant être faite en faveur du célèbre
Phare d’Alexandrie que l’admiration des contemporains avait classé
parmi les sept Merveilles du Monde. Ammien Marcellin en attribue la
construction à Cléopâtre,
mais la critique moderne, appuyée sur les témoignages de Pline, Lucien,
Eusèbe, ne conteste plus à Ptolémée Philadelphe la gloire d’avoir élevé
ce chef-d’œuvre.
Le Phare d’Alexandrie devait sa célébrité autant à ses dimensions colossales qu’à sa beauté. Toutes ses
pierres étaient scellées au plomb pour résister à l’ébranlement des
vagues ; sa base était polygonale, la partie supérieure se
terminant en pyramide. Edrisi, auteur arabe qui vit encore le phare debout
au XIIè siècle, raconte que sa hauteur était « de cent tailles
d’hommes » ; un feu perpétuel brûlait sur la plate-forme
supérieure signalant la terre des Pharaons à près de deux cents kilomètres.
Le moyen âge nous a laissé peu de phares maritimes ; le nom
de phares était donné à cette époque à de petites tourelles que
l’on élevait dans les cimetières, appelées aussi « lanternes
des morts » ; un feu, parfois, y était allumé en mémoire des
trépassés. Cette coutume ancestrale a du reste été reprise à notre époque,
quand on a construit le phare de l’ossuaire de Douaumont.
|
 |
|
Quand on éclairait
les phares au charbon de terre !
Venons-en maintenant au problème essentiel qui est l’éclairage
des phares ; il faut avouer que si certaines « tours à feu »
de l’antiquité surpassaient les nôtres en magnificence, les
dispositifs utilisés pour produire la lumière étaient des plus
imparfaits. Jusqu’en plein XVIIè siècle, au temps de Louis XIII, on
utilisa comme combustible le bois, la houille, les résines, que l’on
faisait brûler, soit à découvert, sur une plate-forme, soit dans une
chambre percée de fenêtres afin de soustraire le feu à l’action du
vent.
Des essais furent faits à
cette époque pour diversifier les phares, les uns brûlant au charbon de
terre, d’autres du charbon de bois ou du bois. Les navigateurs devaient
ainsi deviner, d’après l’aspect de la flamme, à quel fanal ils
avaient affaire ; on peut penser que
d’erreurs et de naufrages furent la conséquence de ces méthodes
primitives !
Un premier perfectionnement consista à remplacer ces foyers archaïques
par des groupes de chandelles protégées par des vitres. Puis, vers 1780,
une amélioration très imporante fut introduite dans les lampes à huile
munies de réflecteurs. Chose incroyable ! ces nouveaux phares à
huile donnèrent si peu de satisfaction aux navigateurs, qu’il fallut en
revenir, à Cordouan, par exemple, à l’ancien système d’éclairage,
c’ est-à-dire au charbon de terre !
Ces mauvais résultats, disons-le tout de suite, n’étaient pas
uniquement imputables à la faiblesse des lampes à huile, mais à la
forme défectueuse des réflecteurs ; nous voyons ainsi se poser pour
la première fois le problème fondamental des phares à grande puissance
qui consiste dans une parfaite répartition de la lumière produite.
C’est à un technicien aujourd’hui trop oublié, Teulère, ingénieur
en chef de la province de Guyenne qu’il appartenait de réaliser cette
distribution d’une manière parfaite par l’invention du miroir
parabolique.
Les premiers phares
à réflecteurs.
Teulère eut l’idée, qui nous paraît aujourd’hui fort simple
mais qu’aucun savant n’avait eue avant lui, de modifier la courbure
des réflecteurs. A la forme sphérique, qui donnait un faisceau
lumineux divergent, il substitua une forme nouvelle, parabolique
qui donne un faisceau parallèle pourvu que la source lumineuse soit placée
exactement au « foyer » de la surface réfléchissante.
C’est la disposition aujourd’hui adoptée pour les projeteurs et les
»phares » d’automobiles.
Il convient d’insister sur cette découverte très importante du
faisceau parallèle qui, seule, a permis aux phares d’atteindre les énormes
portées que nous leur voyons aujourd’hui. Quand les rayons lumineux
divergents se propagent dans l’espace, ils perdent de leur intensité
pour deux raisons ; tout d’abord à cause des pertes inévitables
dues à ce que la transparence de l’air n’est jamais parfaite, et, en
second lieu, à cause de l’élargissement progressif du faisceau :
on conçoit en effet que l’énergie lumineuse se trouvant répartie sur
une sphère de plus en plus grande la quantité de cette énergie qui
arrive en chaque point décroisse rapidement.
Ce dernier effet est le seul qui se fasse sentir dans les espaces
interplanétaires, dont la transparence est pratiquement parfaite ;
c’est ainsi que Vénus, deux fois plus rapprochée du Soleil que la
Terre en reçoit quatre fois plus de lumière et de chaleur. Mais cette
cause de « dispersion » disparaît complètement dans un
faisceau parallèle, en sorte qu’un simple projecteur, optiquement
parfait, si on pouvait le transporter en dehors de l’atmosphère
terrestre deviendrait fort probablement visible des plus lointaines étoiles,
pareil lui-même à une étoile nouvelle au milieu des constellations !
Les
merveilleuses propriétés du « feu à éclipses »
Toutefois, une autre difficulté s’élève maintenant : si
tout le Flux lumineux d’un phare se trouve dirigé vers un certain point
de l’horizon, le feu deviendra complètement invisible de tous les
autres points…ce qui constitue une situation extrêmement fâcheuse pour
un phare ! Teulère imagina donc de faire tourner l’appareil
optique sur lui-même au moyen d’un mouvement d’horlogerie, de façon
à balayer l’étendue avec le faisceau de lumière ; ce denier
conservait ainsi sa puissance tout en n’étant aperçu, pour un
navigateur donné, que par intervalles. C’est ce qu’on appelle le feu
à éclipses, qui est uniquement employé aujourd’hui pour les portées
considérables.
Teulère avec beaucoup de sagacité, s’aperçut d’un autre
avantage, fort inattendu, du »phare à éclipses » qu’il
venait de créer ; le rythme des éclats lumineux permet en effet de
distinguer à première vue, en dehors de toute coloration plus ou moins
caractéristique, le phare auquel on a affaire. Ainsi, deux éclats blancs
se suivant à deux secondes d’intervalle toutes les vingt secondes
forment un signal lumineux très différent d’un seul éclat blanc répété
toutes des dix secondes. Une multitude de signaux, présentant une variété
infinie, a pu de la sorte être créée.
Un catalogue international des phares se trouve aujourd’hui à
bord de chaque navire ; par son emploi combiné avec celui des cartes
marines, ce merveilleux instrument de navigation permet aux bâtiments de
se présenter avec sécurité, de nuit, devant les rivages inconnus.
|
|

|
Comment Fresnel inventa les « lentilles
à échelons »
Les appareils de Teulère comportaient, non plus un feu unique,
mais tout un groupe de lampes, chacune munie d’un réflecteur,
l’ensemble rappelant l’aspect d’une énorme grappe de raisin. Bien
que lourd et monumental, ce dispositif constituait sur les anciennes
chandelles un progrès immense et avait été adopté dans toute
l’Europe.
On en était là en
1819, lorsque Arago, membre de la « commission des phares »,
eut l’occasion de s’adjoindre pour ses travaux un jeune savant,
Augustin Fresnel, qui s’était rendu célèbre par ses mémoires sur la
double réfraction, la diffraction, les interférences et la polarisation
de la lumière. Arago et Fresnel réussirent à appliquer aux lampes des
phares la nouvelle pompe à huile de Carcel ainsi que le principe du bec
circulaire, à double courant d’air, que nous voyons appliquer encore
aujourd’hui dans les lampes à pétrole ; ils purent augmenter
ainsi dans de larges proportions la puissance lumineuse des phares.
Ces perfectionnements, cependant, semblaient insuffisants à
Fresnel ; il rêvait de remplacer les encombrants et imparfaits réflecteurs
de Teulère par de simples lentilles en verre fonctionnant par
transparence. On sait, en effet, qu’une source lumineuse placée au
foyer d’une lentille fournit un faisceau parallèle. Malheureusement
lorsqu’on tente d’appliquer ce système aux phares, on est conduit à
des lentilles gigantesques, donc fort épaisses ; la transparence
devient, par suite, moins bonne et la lentille risque de casser sous
l’influence de la chaleur.
Fresnel eut alors une idée que Buffon avait déjà eue avant lui ;
il réinventa la lentille à échelons. Dans ce nouveau type, la lentille
centrale proprement dite est entourée d’une série de gorges creusées
dans le verre, ou anneaux, ces anneaux constituant des fragments de
lentilles ayant tous leurs foyers au même point que la lentille centrale.
L’ensemble peut être rendu très mince tout en ayant un diamètre
considérable.
Ce principe fut extrêmement perfectionné par Fresnel qui
substitua aux surfaces sphériques, pour les anneaux, des surfaces
toriques, analogues à celle d’un anneau de fumée. Signalons en passant
que des prétentions furent élevées par un physicien anglais, sir David
Brewster, sur l’invention des lentilles à échelons. Prétentions qui
paraîtront singulièrement osées si on songe que l’idée de Brewster
daterait de 1811, alors que Condorcet, dans son « éloge de Buffon »
avant publié tout au long la description des lentilles vingt-trois ans
auparavant. Bien mieux, Brewster lui-même, agissant en qualité d’éditeur
de l’ »Encyclopédie écossaise », avait inséré cet éloge
quelques mois avant sa prétendue découverte ! C’est un petit
travers de caractère de nos voisins que de se rendre difficilement aux évidences
venues du continent et de vouloir tout tirer de leur île.
|
| Le phare « à magnéto » de
la Hève !
Equipée par Fresnel d’une « optique » à peu près
identique à celles que nous employons encore aujourd’hui, la source
lumineuse des phares, constituée encore par une simple lampe à huile de
colza, était fort imparfaite. Il faut arriver jusqu’en 1805 pour
trouver quelques timides essais de lampes à
pétrole et à mèche.
Vers cette époque se place également le premier essai d’éclairage électrique
au moyen d’un arc alimenté…par une machine magnéto-électrique !
Cette magnéto était la fameuse machine de la Compagnie l’Alliance,
comportant 56 aimants permanents en fer à cheval et disposés en étoile ;
elle était mue par une machine à vapeur de deux chevaux. Ce chiffre fera
peut-être sourire ; remarquons cependant que la puissance dépensée
actuellement dans une très grosse lampe de phare excède rarement 6.000
watts, soit 8 chevaux.
L’éclairage électrique fut appliqué tout d’abord en
Angleterre, à Dunverness, puis à la Hève, près du Havre.
|
|
Equipement moderne
des phares de grand atterrage.
Au-dessus des modestes bouées lumineuses, des fanaux
d’alignement ou d’entrée des ports et des phares côtiers, le
« phare de grand atterrage » avec sa portée maxima et ses éclats
blancs rythmés caractéristiques, signale aux navigateurs de haute mer
les caps avancés des continents. Sur leurs appareils optiques à la fois puissants et précis, se
sont concentrés les efforts de la technique la plus moderne.
Les « optiques « de Fresnel ont été conservées,
avec des dimensions quelquefois colossales, nécessitées indirectement
par l’augmentation des volumes propres de certaines sources lumineuses,
manchons incandescents ou filaments de lampes électriques. En effet, plus
la source est volumineuse par rapport à l’équipement optique, plus la
mise au foyer est imparfaite et par conséquent plus le faisceau lumineux
devient divergent au lieu de rester parallèle.
Un peu de divergence doit être cependant laissée au faisceau, au
détriment de sa portée afin que l’éclair ou éclat ait une durée
appréciable ; le chiffre de quatre dixièmes de seconde de durée a
généralement été adopté comme suffisant pour agir pleinement sur l’œil ;
en prolongeant cette durée, on n’augmenterait pas l’impression
lumineuse.
La rotation de ces lourdes et fragiles « optiques »
constitue un problème difficile qui n’a été résolu d’une façon
satisfaisante que par l’utilisation de flotteurs à mercure. Cette ingénieuse
disposition procure un mouvement régulier exempt de coincements et de
vibrations. En revanche, il est inapplicable aux bateaux-phares où l’on
est cependant parvenu à monter des optiques tournantes suspendues à la
Cardant et montées sur billes.
Les arcs électriques sont actuellement en régression ; six
phares seulement en France, les utilisent encore. Ils ont été
victorieusement combattus, dès 1898, par le gros manchon à incandescence
(85 mm. de diamètre) chauffé par le pétrole vaporisé. La brillance
d’un tel manchon peut atteindre 30 bougies
par centimètre carré, ce qui permet de porter l’intensité
axiale, à la sorte de l’optique à 400.000 bougies.
Le manchon à pétrole a dû lui-même reculer devant les progrès
du « gaz d’huile » comprimé à 15 atmosphères, de l’acétylène
dissous à raison de 120 volumes, dans l’acétone et surtout gaz
catalytique, extrait des fuels ou pétroles lourds, et comprimé à 150
atmosphères dans des bouteilles en acier. Ce gaz est fabriqué dans des
usines spéciales situées sur le littoral et livré au service des
Phares.
L’éclairage électrique a connu un renouveau de faveur avec la
création par les fabricants de formes de filaments assez « concentrés »
pour constituer un bon foyer optique. La lampe à filament de tungstène,
avec une « bulle » de plus de 40 cm. de diamètre, permet
d’absorber 6 kilowatts avec un bon rendement lumineux et donne une lumière
très blanche. Des difficultés techniques très grandes ont dû être
vaincues, du fait de l’échauffement de ces énormes ampoules ; le
culot en particulier, doit être refroidi par l’eau.
Cette puissance de 6 kilowatts est assurément minime si on la
compare aux puissances de 100 et 150 kilowatts utilisées dans certaines
lampes émettrices de T.S.F. A cela, on peut répondre que c’est précisément
la merveille des faisceaux parallèles que de transporter efficacement à
de longues distances, sans déperdition excessive, de petites quantités
d’énergie. L’effroyable gaspillage auquel se livrent les postes
actuels de T.S.F. en rayonnant dans toutes les directions pourra être
largement diminué dans l’avenir par l’emploi des ondes dirigées qui
constituent l’équivalent exact des faisceaux lumineux parallèles.
Les plus fortes intensité lumineuses aujourd’hui réalisées
atteignent, à notre connaissance, 7 à 8.000 bougies, pour la source ce
qui correspond, pour l’intensité axiale du phare, au chiffre formidable
de 30 à 40 millions de bougies !
|

|
|

|
La difficile
construction des « phares sur écueil ».
Passons maintenant à l’édification des tours destinées à
porter le feu, qui constitue, dans bien des cas, l’un des problèmes les
plus ardus posés à l’ingéniosité humaine.
Des phares gardés ou de simples tourelles de signalisation doivent
parfois être construits sur des rochers offrant très peu d’émergence
à la haute mer, ou sur des récifs à fleur d’eau, voire sur des roches
complètement sous-marines. La première opération à effectuer consiste
dans ces cas, en profitant des rares journées de « calme plat »,
à se rendre dans ces parages dangereux afin de reconnaître avec précision
la forme de la roche, la répartition des courants suivant l’heure de la
marée et les vents, la profondeur d’eau la plus favorable pour le
travail, en un mot, le régime marin de l’écueil.
Dans les voyages ultérieurs, on emmène des ouvriers qui profitent
des heures de présence pour forer quelques trous où l’on place des
crampons scellés qui faciliteront les accostages ; on se rend compte
de la nature de la roche qui peut se trouver creuse, feuilletée ou fissurée. Le phare de la Jument, par exemple, avait été bâti sur une
roche d’aspect sain, mais où se forma une large excavation qui faillit
entraîner la ruine du phare.
Quelques heures, de loin en loin, peuvent seules être consacrées
à ces travaux préliminaires et les ingénieurs s’estiment souvent fort
heureux, quand à la fin de la belle saison, les résultats de l’année
atteignent 10 ou 15 crampons plantés dans la roche !
Dès que le baromètre permet d’espérer une période de beau
temps, on envoie sur place un vapeur assez important avec des canots et
une chaloupe, La chaloupe est amarrée à proximité de l’écueil entre
des bouées disposées en étoile, ces bouées elle-mêmes étant reliées
à de lourds corps morts en fonte ; le vapeur se tient à distance en
eau profonde. Quant aux canots, ils permettent d’aborder, tant bien que
mal, la roche, en la talonnant à chaque coup de mer.
On trouve généralement la roche couverte d’une couche
extraordinairement épaisse de goémons que l’on détruit avec de
l’acide, des brosses en fil d’acier et à l’aide de demi-cartouches
de cheddite. Ce dernier procédé exige quelques précautions pour ne pas
étonner, c’est-à-dire fendiller la roche. Il est avantageux,
lorsqu’on quitte le travail au retour de la marée, de laisser des chaînes
accrochées aux crampons : leur ragage continuel, sous l’action des
vagues, finit par avoir raison des goémons les plus compacts.
Dans la roche dénudée, on taille au pic ou au fleuret des redans
ou entailles et tout aussitôt on accroche dans ces entailles les
fondations de petites murettes disposées de façon à protéger les
ouvriers contre les vagues. Dans les cas menaçants, on utilise des sacs
à larges mailles remplis de « ciment prompt » qu’on empile
et qu’on mouille : un tel » mur » peut être durci en
très peu de temps.
|
| Comment on coule le béton sous la
mer
Pour commencer les fondations proprement dites, le procédé des
casiers à donné des résultats remarquables. Il consiste à utiliser de
larges panneaux à ossatures de fer sur lesquels sont tendues des toiles métalliques
serrées ; ces panneaux sont préparés à la demande d’après les
mesures prises pour un scaphandrier qui est également chargé de les
amarrer en place, au moyen de cordes sous-marines, tout autour du rocher.
On « coule » ensuite, le plus rapidement possible, du béton
de Portland, qui a la propriété de se solidifier sous l’eau. La roche
se trouve ainsi ceinturée d’un massif solide sur lequel pourront
continuer les travaux.
Ces opérations sont très délicates et souvent impossibles, à
cause du « batillement » des vagues. A la tour des
Moines, en Corse, des vides subsistèrent entre le ciment et la roche et
les massifs furent enlevés par la mer.
Ajoutons que les caissons en acier, qui constituent le matériel
ultra-moderne pour les fondations en rivière, donnent ici des résultats
beaucoup moins favorables. La mer les pousse, les soulève, les déplace,
sans arrêt, au cours de la mise en place : ils finissent par se
cabosser tout en dégradant la roche et doivent être retirés. A
Rochebonne, près de la Rochelle, on a tenté pendant quatre ans de mettre
en place un caisson de 14 mètres de diamètre sans y parvenir. A l’île
de Ré, le phare de Chanchardon, construit sur caissons, se mit un beau
jour à osciller sur sa base et il fallut le consolider à grand frais.
Le corps même des phares ou fût est « ancré » dans
le massif de fondation et dans la roche par des tirants verticaux en acier
qui viennent se réunir aux armatures du béton. Malgré cet amarrage
robuste, il arrive assez souvent que les petites ouvrages soient « recépés »,
c’est-à-dire fauchés par la mer, comme la tourelle d’Astan, près de
Roscoff, qui fut enlevée quatre fois et dut finalement être remplacée
par une bouée.
Il ne faut pas oublier, également, que la roche elle-même peut céder,
par suite de l’énorme bras de levier offert aux vagues par la tour :
c’est ce qui est arrivé à la Jument de Penmarc'h.
|
|
La périlleuse
existence des gardiens de phare.
On peut se faire une idée, par ce qui précède, des incroyables périls
où se trouvent exposés les ouvriers dans la construction des phares.
Pour sceller les premiers crampons d’Ar-Men, les hommes travaillaient
munis de ceintures de sauvetage et attachés avec des cordes. Ils se
laissaient emporter ou s’aplatissaient au passage des lames ; le
cas n’est pas exceptionnel. S’il arrive qu’un de ces malheureux se
trouve emporté par le courant du côté d’un champ de récifs, il
deveint pratiquement impossible d’aventurer un bateau pour lui porter
secours.
Dans les phares terminés, les gardiens se trouvent parfois soumis,
eux aussi, à des attaques impressionnantes : glaces brisées, malgré
la hauteur de la tour, par les vagues qui s’élèvent le long du fût et
viennent coiffer la lanterne, irruptions d’eau torrentielle, lampes éteintes.
A la Jument en 1911, 65 kgs de mercure furent projetés hors du bassin de
support de l’ »optique », provoquant un commencement
d’intoxication chez les gardiens. En 1916, dans ce même phare, l’eau
entra dans la lanterne et détruisit le manchon ; les verres des
lampes de secours furent tous cassés par l’ébranlement de la tour et,
cette nuit-là, le phare s’éteignit.
C’est donc une vie singulièrement rude et éprouvante que celle
de ces gardiens de phare, parfois logés sur un écueil si exigu qu’on
ne peut y aborder et que le débarquement doit s’y effectuer par un
va-et-vient aérien. Les progrès de la science n’ont atténué que dans
une faible mesure cet isolement, la T.S.F. n’existant que dans certains
grands phares. Des souscriptions avaient été ouvertes, il y a quelques
années, en vue d’offrir à ces isolés des postes de réception ;
c’était là une initiative fort heureuse et qui mériterait d’être
poursuivie.
La création des postes automatiques ou commandés à distance,
pour l’émission de signaux lumineux et sonores, a permis, il est vrai,
de supprimer le personnel dans certains points dangereux. Mais ces
innovations sont restées réservées aux postes secondaires, car une défaillance
des mécanismes présenterait de trop graves dangers dans les feux de
premier ordre. Là, des hommes sont indispensables.
Dans les services des phares comme dans la marine, les
perfectionnements mécaniques sont peu de chose sans la valeur
personnelle, le courage moral et même physique, le « cran » :
à la mer : il faut payer de sa personne.
|

|
|
|
|
|
|
|