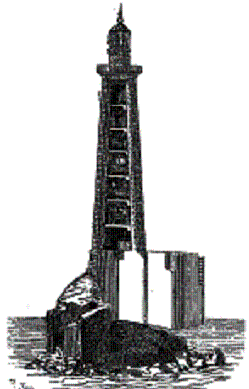Nous donnons à nos lecteurs une carte qui prouve d’une manière
saisissante la grande nécessité du phare que l’on est heureux de pouvoir
construire actuellement sur la roche Ar-Men, à l’extrémité occidentale de
la chaussée de Sein. Le nom Ar-Men signifie, en bas breton, la pierre.
Lorsque les navires se rendent à Brest, ils ont à s’engager dans
l’espace de mer nommé l’Iroise, bordé au nord et au sud par des
hauts-fonds hérissés de têtes de roches innombrables et sur lesquels ils se
perdraient infailliblement. On s’en rend parfaitement compte avec la carte.
L’intervalle libre qui sépare la chaussée des Pierres-Noires, sur
la limite septentrionale de l’Iroise, et la chaussée de Sein, sur la limite
méridionale, ne dépasse guère une douzaine de milles marins[1].
Plusieurs phares facilitent la navigation de ces parages. Au nord, ce
sont ceux : 1° de l’île d’Ouessant, avec une trompette à vapeur ;
2° des Pierres-Noires, avec une cloche ; 3° de la pointe
Saint-Mathieu et de la pointe du Minou, qui, vus l’un par l’autre, forment
un alignement très précieux pour se diriger vers l’entrée du goulet ;
4° de la pointe Toulinguet et de la pointe des Capucins sur la presqu’île
de Kelern ; ils fournissent aux navigateurs des indications suffisantes.
Au sud de l’Iroise, on trouve deux phares seulement : celui de
la pointe du Raz, au bord de la baie des Trépassés de lugubre mémoire, et
celui de l’île de Sein, érigé à cinq milles dans l’ouest du précédent.
L’éclairage de cette partie de la côte est loin de suffire, car, à la
suite de l’île, la chaussée de Sein se prolonge au large jusqu’à huit
milles (environ quinze kilomètres). C’est une affreuse chaîne de roches
entre lesquelles la mer fait rage avec des courants de foudre. A mesure que
ces roches s’éloignent de l’île de Sein, dans l’ouest, elles
s’abaissent de plus en plus ; quelques-unes ne découvrent qu’aux
plus basses marées, et le plus grand nombre reste à fleur d’eau. L’extrémité
la plus avancée de la chaussée se termine par des hauts-fonds dont les
marins naviguant dans ces parages ne peuvent juger exactement la position
faute de repères.
Les seuls objets qui puissent servir de reconnaissance à un marin pour
se rendre compte de la position de son navire, lorsqu’il approche de la
chaussée de Sein, sont les deux phares. La ligne droite qui passerait par
l’un et par l’autre passe aussi par l’extrémité occidentale de la
chaussée, de sorte qu’un capitaine de marine qui attaque l’atterrage de
Brest par le sud de l’Iroise saura que s’il distingue le phare de l’île
à droite ou à gauche du phare de la pointe du Raz ou dans le même
alignement, son navire est au nord ou au sud, ou dans la direction même de la
chaussée de Sein.
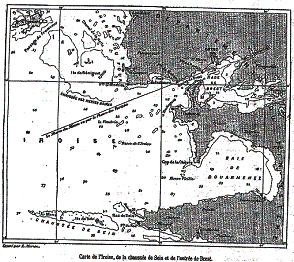
Mais si l’atmosphère est brumeuse, la portée de l’éclairage des
phares pourra ne pas dépasser la limite des dangers, et le marin courrait le
risque de donner sur les roches en se rapprochant de la terre pour reconnaître
les feux. D’ailleurs, même en temps très clair, le phare de l’île est
trop en dedans des récifs et trop éloigné de l’extrémité de la chaussée
de Sein pour qu’un navigateur puisse apprécier la distance où il se trouve
de cette extrémité lorsqu’il a ce phare en vue.
Il était donc de la plus grande importance de placer un feu au large
sur les dernières roches de la chaîne des récifs. On le savait bien en
1825, alors qu’on s’attachait à compléter l’éclairage maritime ;
mais on n’aurait pu faire mieux que ce que l’on fit alors, c’est-à-dire
la construction des deux phares dans la position qu’ils occupent. Le lecteur
en jugera par le détail des difficultés que nous allons décrire, et que les
ingénieurs sont maintenant en état de surmonter, avec l’aide de procédés
et de ressources dont on ne disposait pas il y a un demi-siècle.
Sur la demande de la direction des phares, une commission d’ingénieurs
et d’officiers de marine fit, en juillet 1860, une nouvelle et très sérieuse
reconnaissance de l’extrémité de la chaussée de Sein. Elle s’assura que
trois têtes de roches apparaissaient au-dessus de l’eau dans les grandes
basses mers, et que deux d’entre elles affleuraient à peine, tandis que la
troisième, Ar-Men, émergeait d’environ 1m.50. La commission, après avoir
essayé vainement de débarquer sur Ar-Men, dont les dimensions lui
paraissaient d’ailleurs insuffisantes, fut conduite à proposer une roche
beaucoup plus rapprochée de l’île pour servir à l’érection du phare
projeté. C’eût été une trop faible amélioration à l’état de choses
existant. Toute solution fut donc ajournée.
Cependant, l’établissement d’une ligne de paquebots
transatlantiques entre Le Havre et New York avec escale à Brest rendait plus
impérieux le besoin d’un meilleur éclairage de la chaussée de Sein. Les
navires appartenant à une compagnie commerciale de transports n’ont pas,
comme ceux de l’Etat, le loisir d’attendre quelque temps au large une
atmosphère assez claire pour leur permettre de prendre connaissance des bouées
et des feux ; ils sont obligés d’arriver à peu près à jour fixe ;
cette régularité est la condition de leur succès. Le phare à ériger vers
l’extrémité de la chaussée de Sein revint donc en question. Un ingénieur
hydrographe expérimenté, M. Ploix, fut chargé d’une nouvelle
reconnaissance en 1866. Il ne fut pas plus heureux que la commission de 1860
dans ses tentatives d’abordage sur la roche Ar-Men ; il n’en put
approcher qu’à la distance de quinze mètres ; mais il se convainquit
à un tel degré de la nécessité d’un phare sur ce point dangereux,
qu’il insista vivement dans son rapport pour qu’on « tentât
l’impossible ».
Quelques temps après, M. Joly, ingénieur des Ponts et Chaussées,
rangea la roche de plus près, et put s’assurer que la surface découverte
aux basses mers était fort inégale, fissurée, et ne présentait que huit mètres
de large sur douze ou quinze de long. On désirait mieux, mais il fallait se
contenter de ce qu’on avait. On continua donc à chercher les chances de débarquement.
Enfin, cette même année 1866, le syndic des gens de mer de l’île
de Sein, rencontrant une circonstance favorable, parvint à descendre sur la
roche ; il en détacha un échantillon : c’est un gneiss d’une
certaine dureté, bien qu’étant en décomposition sur quelques points.
Dès lors, on se prépara pour l’exécution. M. Léonce Reynaud,
l’habile et expérimenté directeur des phares, conçut et arrêta les
parties essentielles de la construction. Il fut décidé que la surface de la
roche serait percée, sur tout l’emplacement destiné au phare, par des
trous de trente centimètres de profondeur, espacés de mètre en mètre ;
qu’on y scellerait des goujons en fer ayant le double but de fixer la maçonnerie
sur le rocher et de relier les parties fissurées en les rendant solidaires du
bloc compact qui devait être construit au-dessus d’elles. Il fut également
décidé qu’on introduirait successivement dans la maçonnerie, pendant
qu’elle s’élèverait, d’autres goujons verticaux et de fortes chaînes
horizontales en fer qui solidifieraient en les reliant entre elles toutes les
assises de la construction.
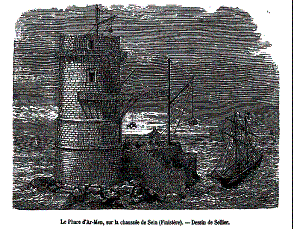
Il n’était pas prudent de confier à des maçons ordinaires le soin
de percer des trous de fleuret sur une roche si rarement abordable et sans
cesse battue de la mer, même de beau temps et à basse marée. Ce fut aux pêcheurs
de l’île de Sein que les ingénieurs s’adressèrent. Ces marins, qui exerçaient
depuis l’enfance leur industrie au milieu des roches de la chaussée,
avaient plus de facilités que tous autres ouvriers pour juger les occasions
favorables à un débarquement sur Ar-Men, pour en profiter, et pour ne
quitter qu’à la dernière minute le travail du creusement.
On
se mit d’accord pour commencer en 1867.
Cette année-là, dès que le vent, l’état de la mer et le niveau de
la basse marée faisaient présumer la possibilité de descendre sur Ar-Men,
des bateaux de pêcheurs y arrivaient de divers côtés. De chacun d’eux
sortaient deux hommes, munis de ceintures de liège, qui se couchaient sur la
roche, s’y cramponnaient, et travaillaient fiévreusement à percer des
trous en dépit des assauts de la vague. Lorsqu’un d’eux était emporté
par la mer, une barque s’élançait à sa suite, le repêchait, et le
ramenait sur le travail.
La première campagne fut assez heureuse pour qu’on pût bien augurer
du succès de l’entreprise. Cependant, ce premier résultat pa-raîtra bien
mince, car on ne put, dans tout le cours de la belle saison, se cramponner à
la roche que sept fois ; on ne put y rester que huit heures en tout, et
l’on ne parvint à creuser que quinze trous sur les points les plus élevés
de la surface.
L’année suivante, 1868, il fallut opérer sur des points plus bas, où
l’ouvrier était le plus souvent submergé ; mais on avait acquis de
l’habitude, et la saison fut plus favorable. On eut seize débarquements,
dix-huit heures de travail, et l’on put percer quarante trous. On parvint
aussi à faire le dérasement des inégalités de la surface, afin de rendre
plus facile la construction de la première assise.
Aucune description ne démontrerait mieux que les chiffres précédents
les difficultés du travail et le courage obstiné des pêcheurs. C’étaient
comme des soldats montant hardiment à l’assaut, mais non pour égorger
leurs semblables au sommet de la brèche ; ils voulaient au contraire
assurer, au prix de fatigues et de périls inouïs, la construction d’un édifice
de salut destiné à faire éviter aux navigateurs ces récits funestes où le
vent et la mer les poussent implacablement durant les longues nuits
hivernales.
En l’année 1869, on eut vingt-quatre accostages, et l’on put
demeurer quarante-deux heures dix minutes au travail. C’est l’année la
plus favorable qu’on ait eue jusqu’en 1877 ; elle vit commencer la
construction. On employa d’abord de petits moellons bruts et un ciment dont
la prise était des plus rapides ; cette rapidité de prise était
absolument nécessaire au milieu des lames qui brisaient sur la roche et
arrachaient parfois la pierre aux mains de l’ouvrier. Un marin en vedette
annonçait les accalmies et l’arrivée des grosses vagues ; les maçons
en profitaient ou pour agir, ou pour se cramponner ; ils avaient
d’ailleurs des ceintures de sauvetage et étaient chaussés d’espadrilles
pour marcher plus sûrement. – Le personnel arrivait sur une chaloupe à
vapeur remorquant les canots d’accostage et portant les matériaux. – A la
fin de cette première campagne, on avait exécuté vingt-cinq mètres cubes
de maçonnerie, que l’on retrouva intacts l’année suivante. L’espérance
se fortifia dès lors, et l’on ne douta plus du succès de l’entreprise.
Les accostages des années suivantes jusqu’en 1877 furent au nombre
de 8, 12, 13, 6, 18, 23, 23 et 30 ; 30 aussi en 1878 ; les durées
du séjour sur la roche furent de 18 h.5m., 22h.10m., 34h.20m., 15h.25m.,
60h.10m., 110h.55m., 162h.45m., 261h. Il n’y a eu que 207h.30m. en 1878, où
l’on a ajouté 125m³ de maçonnerie aux 702m³85 déjà construits, et
100.000 francs de dépenses aux 517.136 francs des années précédentes.
Hâtons-nous de dire que les conditions d’accostage et de séjour
s’amélioraient progressivement par suite de l’avancement des travaux. On
avait installé sur Ar-Men un mât de charge, afin de faciliter le débarquement
des matériaux. La hauteur croissante des assises de la construction
permettait aussi de demeurer plus longtemps à chaque marée. Ce n’est
qu’en 1874 que le massif de maçonnerie atteignit et dépassa le niveau des
hautes mers ; jusqu’alors les grandes eaux l’avaient couvert.
Parmi les difficultés de l’entreprise, il faut compter celle
d’installer des appareils et d’employer un nombreux personnel sur
l’espace restreint que présente la tête de la roche. Il faut remarquer
aussi que plus l’édifice s’élève et plus grande est la hauteur à
laquelle il faut monter les matériaux ; les soins de la maçonnerie des
parties supérieures demandent aussi plus de temps. Le nombre des accostages
et la durée des séjours sur Ar-Men sont encore des éléments très
influents de la dépense. Ainsi, le mètre cube de maçonnerie, qui a coûté
jusqu’en 1870 plus de 2.000 francs, n’a plus coûté que 726 francs en
1871 et 1872 ; il a remonté à près de 3.000 francs en 1873, est
descendu à 375 francs en 1875. La moyenne jusqu’en 1878 est de 736 francs.
A la fin de cette année, la hauteur totale de la portion bâtie est de 23m.90 ;
elle est de 19m.40 au-dessus des hautes mers. Le phare aura son foyer élevé
à 28m.80 au-dessus de ces hautes mers ; il sera de second ordre, à feu
scintillant. On aurait voulu, mais on n’a pas osé dépasser cette limite,
de crainte de compromettre la stabilité d’une haute construction édifiée
sur une base d’un diamètre si restreint (7m.20).
Toute la flottille attachée à la construction du phare Ar-Men a été
commandée depuis le commencement des travaux par un homme très dévoué, le
contremaître au cabotage Pouquet. L’accostage de la roche s’est exécuté
constamment sous les ordres du pilote Coquet, jusqu’à la campagne de 1876,
et ensuite sous ceux du pilote Guilcher. Ces deux marins, également
remarquables par la sûreté du jugement, par le courage et le sang-froid, ont
rendu les plus grands services dans cette hardie entreprise, qui a toujours été
difficile et presque toujours très dangereuse.
Les beaux travaux de la construction du phare Ar-Men ont été conçus
et arrêtés en ce qui est essentiel par M. Léonce Reynaud, directeur du
service des phares. Deux ingénieurs en chef, MM. Planchat et Fénoux, en ont
eu successivement la direction ; trois ingénieurs ordinaires y ont pris
une part active : MM. Joly, de 1867 à 1868 ; Cahen, de 1868 à 1874 ;
Mengin, depuis 1875. Le conducteur Lacroix, en 1869 et 1870, et, depuis 1871,
le conducteur Roberteau, ont eu la surveillance des chantiers.
Nous avons voulu consigner tous ces noms dans le Magasin pittoresque,
parce qu’ils méritent la reconnaissance des marins pour l’oeuvre périlleuse
et bienfaisante à laquelle ils ont été voués.