|
Les côtes de la Gaule ne possédaient que six
phares. Ils sont maintenant des centaines et la France aura le plus
puissant du monde, à Créac'h, près d'Ouessant, avec ses 185 km de
portée, son avertisseur sonore entendu jusqu'à 3,6 km, sa tour de 70 m
de haut sur une plate-forme de 30 m au-dessus de la mer, pouvant
résister à un vent de 200 km/h et à une houle de 30 m de haut. Les
premiers phares furent infiniment plus modestes. Quand a-t-on commencé
à guider la route de la mer par des feux ? Comment les phares ont-ils
évolué au cours des siècles ? Que deviendront-ils ?
DEPUIS TRENTE SIÈCLES que les phares existent, on
pouvait les croire presque éternels. Les brasiers dansants des tours à
feu guidèrent les pas hésitants des premières civilisations maritimes,
comme le pinceau lumineux géant de Créac'h permet aujourd'hui aux
superpétroliers de s'engager dans le rail d'Ouessant. Pourtant,
l'importance de leur rôle est vouée à diminuer et, dans quelques
décennies, ces bâtiments familiers, rendus obsolètes par les balises
automatiques et les satellites, ne seront peut-être plus que des
témoins du passé, au même titre que les aqueducs romains. Sans doute
est-ce la raison de l'indifférence que notre fin de siècle manifeste à
leur égard. Alors que, pour les anciens, deux des Sept Merveilles du
monde étaient des phares — ou du moins supposés tels, car le Colosse de
Rhodes n'a vraisemblablement jamais rempli ce rôle —, alors que Cordouan
fut, avec Notre-Dame de Paris, le premier édifice classé monument
historique, beaucoup de nos contemporains ignorent qu'ils remplissent
encore une fonction indispensable à la navigation. Le silence des
écrivains est à cet égard révélateur : en dehors de quelques œuvres,
souvent talentueuses et érudites, de Le Cunff, Faille ou Queffelec, la
littérature du siècle écoulé ignore résolument les phares alors que
jamais le grand public ne s'est autant passionné pour les choses de la
mer.
D'où
viennent-ils ?
On ne sait trop si c'est en Libye ou en Grèce
qu'apparurent les premiers phares, ni exactement à quelle époque. Les
récits mythologiques qui les évoquent ne donnent que rarement des
indications, chronologiques et géographiques, fiables.
Tout au plus peut-on parfois supposer l'existence
de tel ou tel phare à partir d'une légende comportant quelques
précisions toponymiques ou renvoyant à des repères historiques
indentifiables.
Ainsi, celle qui raconte les amours tragiques de
la prêtresse Héro et de Léandre. Chaque nuit, Léandre traversait à la
nage l'Hellespont pour voir celle qu'il aimait et Héro le guidait avec
une torche. Une nuit, la tempête éteignit le flambeau et Léandre se
noya... Or, au débouché des Dardanelles dans la mer de Marmara (ou de
l'Hellespont dans la Propontide, pour employer la toponymie antique)
deux tours étaient, selon Strabon, construites face à face de part et
d'autre du détroit. L'une, près de Lesbos, portait le nom de Héro,
l'autre près d'Abydos, celui de Léandre. L'histoire et la mythologie, on
le voit, se confortent l'une l'autre.
Un mythe aussi ancien que celui des Cyclopes est
même interprété par Léon Renard (2) comme une incarnation poétique de l'œil
unique des phares. « Le massacre des Cyclopes tués à coups de flèches
par Apollon, écrit-il, se rapporterait assez bien à la manière dont les
fanaux des tours cyclopéennes, placées sur les tours orientales de la
Sicile, étaient éteints par les rayons du soleil. »
 |
La ruse de Sostrate
Mais si une interrogation subsistera toujours
quant à la réalité de phares attestés seulement par des légendes ou même
par un témoignage unique d'historien — quoique Strabon soit en général
crédible — il en est un dont l'existence ne fait aucun doute : celui
d'Alexandrie, établi sur l'îlot de Pharos, nom propre que son immense
renommée allait, comme un suprême hommage, transformer en nom commun.
Construit au début du IIIe siècle avant J.-C., soit
sous le règne de Ptolémée Soter, soit sous celui de son fils Ptolémée
Philadelphe, il ne disparut qu'en août 1303 de notre ère, ruiné de fond
en comble par un tremblement de terre. Son feu avait brillé treize
siècles, et les géographes, les voyageurs ou les simples curieux grecs,
romains, arabes sont si nombreux à l'avoir décrit que l'on peut se faire
une idée très précise de sa configuration.
Sa hauteur devait être largement supérieure à cent
mètres, ce qui est considérable au vu des normes architecturales
antiques. Son feu brûlait vraisemblablement à l'air libre, ce qui devait
lui donner une portée très faible de nuit, malgré sa hauteur. En
revanche, de jour, sa colonne de fumée était certainement visible à
plusieurs dizaines de milles, sans que l'on puisse être plus précis, les
témoignages étant sur ce point flous, voire fantaisistes.
Son architecte — déjà célèbre dans l'Antiquité
pour d'autres travaux remarquables — est Sostrate de Cnide, dont nous ne
savons qu'il est l'auteur du Pharos que grâce à la ruse qu'il employa :
ayant fait graver dans la pierre l'inscription suivante : Sostrate,
Cnidien, fils de Dexiphane, aux dieux sauveurs pour le salut des
navigateurs, il la fit dissimuler sous un lit de chaux et inscrivit sur
cet enduit le nom de son souverain. Il évitait ainsi la colère du
monarque, tout en sachant qu'au bout de quelques décennies, l'enduit
disparaîtrait et que son nom serait transmis à la postérité...
Si le phare d'Alexandrie avait frappé les voyageurs
de l'Antiquité et du Moyen Âge, c'était certes à cause de ses dimensions
inusitées, mais aussi parce que, malgré son utilité évidente, il ne
fut guère imité. Les romains construisirent bien quelques phares sur
les côtes de la Méditerranée, de l'Atlantique et de la Manche, mais leur
nombre — six sur les côtes de la Gaule, par exemple — reste fort
modeste. |
Le
roi a un appartement dans le phare de Cordouan
Au total, les phares de l'Antiquité ne furent
qu'une trentaine au maximum, quinze si l'on s'en tient aux certitudes.
Quant aux hommes du Moyen Age, ils n'en construisirent guère, et encore
s'agit-il de tours à feu sommaires dont l'existence n'est pas toujours
avérée.
Quelques exceptions notables doivent cependant
être signalées, telles que la construction du phare de Gênes, ou, plus
près de nous, à la fin de la Renaissance, celle de Cordouan, le « phare
roi ».
L'embouchure de la Gironde présente de réels
dangers pour la navigation, et malgré la négligence dont firent preuve
au Moyen Âge les princes et les villes côtières, il est à peu près
certain que des tours à feu furent régulièrement entretenues en face de
la pointe de Verdon dès Louis le Débonnaire.
La dernière connue, que l'on sait avoir été
construite sous le règne du Prince Noir au début du XVe siècle, s'était
vite dégradée sous l'effet des intempéries. En 1581, son état est devenu
à ce point inquiétant que le maire de Bordeaux, Michel de Montaigne,
fait appel à un architecte fameux, Louis de Foix, pour estimer l'ampleur
des travaux à effectuer. Le diagnostic est sans appel : il faut démolir,
et reconstruire.
Au printemps 1584, Louis de Foix entamait la
construction du phare de Cordouan, dont il voulait faire l'œuvre de sa
vie. L'édifice serait non seulement un phare, mais aussi une résidence
royale, une forteresse et une église. Mais les difficultés furent telles
— financières, politiques, techniques — que quand Louis de Foix mourut
en 1602, Cordouan était encore inachevé. Son fils Pierre reprit les
travaux, et abandonna en 1606. Et c'est finalement Louis Beuscher, un
ancien conducteur des travaux de Louis de Foix, qui acheva l'édifice en
1611.
|
LES BATEAUX-FEUX
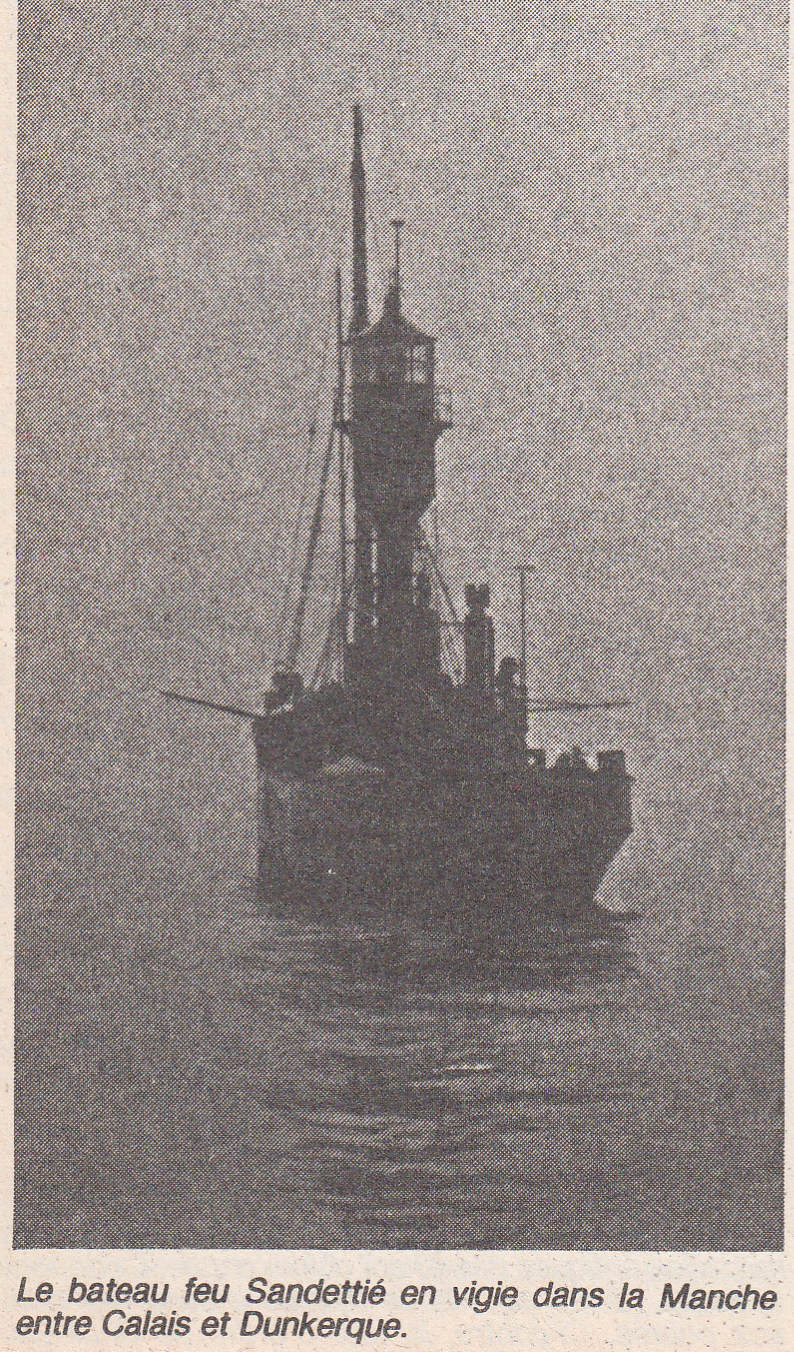 |
Dans les zones de hauts-fonds dépourvus d'assises
rocheuses, comme en certains points des côtes de la Mer
du Nord, il est impossible d'édifier des tours. Or les
dangers pour la navigation n'y sont pas moins grands que
dans les régions des récifs. C'est, dit-on, à un ancien
barbier Anglais que l'on doit, au début du XVIIIè
siècle, l'invention des bateaux à feux. Sa femme lui
ayant apporté en dot un petit caboteur, il eut l'idée
d'ancrer son bateau à l'embouchure de la Tamise et d'y
allumer chaque nuit un fanal, tâche moins fatigante à
ses yeux que de transporter du charbon de port en port,
ce qui avait été jusque là son activité. Il ne lui
restait plus qu'à lever des droits sur les navires
entrants et sortants, ce que les capitaines acceptèrent
sans difficulté, car la zone de Nore-Sand où il s'était
installé était dangereuse et mal balisée !
La
vie à bord des bateaux-feux a toujours été très dure,
car à la différence d'un phare, un bateau-feu roule et
tangue, et subit en permanence le choc du rappel des
énormes chaînes auquel il est amarré. Et si les relèves
sont moins périlleuses, elles ne sont pas moins
incertaines en cas de gros temps.
Leur nombre ne cesse de diminuer dans le monde, car le
coût de leur entretien est élevé et la portée de leur
feu est faible. Ils sont progressivement remplacés par
des bouées automatiques. En France, il n'en reste que
deux, le Bassurelle et le Sandettié, au large de
Boulogne pour le premier, de Calais pour le second.
Ils
seront vraisemblablement désarmés avant la fin du
siècle.
|
| |
|
|
Un
chef-d'œuvre défiguré
Cordouan était bien le chef-d’œuvre
qu'avait rêvé son architecte. Monument baroque et fou, il
élevait sa lanterne à trente-sept mètres au-dessus du niveau de
la mer. Ses trois étages comprenaient une grande salle,
l'appartement du Roi, et une chapelle de marbre. Pilastres,
frontons néo-grecs, colonnes et échauguettes en faisaient un
des plus purs modèles architecturaux du temps.
Hélas ! A la fin du XVIIIè siècle, les
capitaines bordelais exigèrent et obtinrent que l'on surélevât
le phare de vingt mètres. L'unité architecturale de l'oeuvre de
Louis de Foix fut à jamais perdue.
Défiguré, mais sauvé par cet exhaussement.
Courdouan reste pourtant le chef- d'œuvre de la pharologie.
Il y a quelques années, Cordouan a failli
être déclassé et abandonné aux vents et aux vagues. Mais un
puissant mouvement d'opinion, mené par le Syndicat d'initiative
de Verdon, la presse et les élus locaux lui a redonné vie, pour
quelques siècles encore, peut-être.
400
phares de l'Empire à 1914
À part l'épisode exceptionnel que représente la
construction de Cordouan, il faudra attendre le milieu du XVIIè siècle
pour que la résurrection des phares s'amorce, timidement en France,
vigoureusement en Angleterre.
Mais, à l'aube de la Révolution industrielle, en
1800, il n'y avait encore que vingt-quatre phares sur les côtes
françaises...
Le XIXè siècle allait consentir un prodigieux
effort dans le domaine de la pharologie, puisqu'en France près de
quatre cents phares furent édifiés du Premier Empire à la Grande Guerre.
Leur construction, si elle ne représenta guère de problèmes lorsque les
tours furent bâties sur le littoral lui-même, releva parfois de
l'exploit quand on décida de les élever en pleine mer, sur des assises
rocheuses presque en permanence submergées.
Ar-Men, sur la Chaussée de Sein, et la Jument, au
large d'Ouessant, sont d'admirables exemples de ce que la ténacité des
hommes peut accomplir. Ces deux phares ont bien des points communs :
construits en pleine mer, dans des parages considérés comme faisant
partie des plus dangereux du monde, ils se dressent sur des récifs que
la mer ne découvre qu'à marée basse, à condition que le temps soit beau
et la mer calme, c'est-à-dire très rarement.
La superficie de la roche utilisable était dans les
deux cas de 100 m2 environ. L'accostage, enfin, n'était permis que
rarement et pour de très courtes durées : la première année des travaux,
les ouvriers purent débarquer sept fois à Ar-Men et travailler huit
heures, dix-sept fois à la Jument et travailler cinquante et une heures
! Quant aux conditions de travail, elles furent terribles : les
malheureux pêcheurs recrutés pour l'occasion devaient se tenir à plat
ventre pour ne pas être emportés par les déferlantes et ne travaillaient
que d'une main, l'autre leur servant à se cramponner au rocher gluant.
Bien sûr, une fois le récif nettoyé et aplani, et
les premières pierres posées, les ouvriers se retrouvaient dans une
situation moins pénible. Mais le débarquement des hommes et du matériel
continuait à poser les mêmes problèmes qu'aux premiers jours : c'est
ainsi qu'à Ar-Men, sept ans après le début des travaux, six accostages
furent seulement réussis, permettant en tout et pour tout quinze heures
de travail ! On ne s'étonne pas qu'il ait fallu sept ans d'acharnement
pour construire la Jument, et quatorze pour Ar-Men...
|
 |
 |
Quand le sommet oscille de dizaines de centimètres
Si les gardiens de phare ne travaillent pas dans
les mêmes conditions que leurs ancêtres constructeurs, leur vie, même
aujourd'hui, n'est pas sans risque. Mais ils sont si discrets, si
taciturnes qu'il faut beaucoup de patience pour les décider à lever un
coin de voile sur leurs travaux et leur peines.
Issus le plus souvent d'une famille de marins,
comptant presque toujours des gardiens parmi leurs proches et leurs
ascendants, ils considèrent avec un flegme étonnant ce qui, pour les
terriens, relève de l'héroïsme au quotidien. Et pourtant, combien de
touristes encore, après avoir visité leur phare dont ils sont si fiers,
croient, en leur laissant une pièce, avoir en face d'eux une sorte de
guide délégué par le Syndicat d'initiative local !
Leur vie est en fait un affrontement permanent avec
la mer, comme celle des marins, leurs cousins, du moins quand ils
effectuent leurs longues années de service dans les phares isolés au
large. Le rythme du travail est de quinze jours en mer, quinze à terre,
huit en mer, huit à terre.
Cet emploi du temps n'est léger qu'en apparence :
les jours passés en mer sont longs et comme les phares sont, par
définition, édifiés dans des zones dangereuses où la tempête sévit
plusieurs mois par an, les conditions d'existence sont aussi rudes,
voire plus rudes, que dans un bateau. Il faut savoir qu'une tour vibre
et gémit sous les coups de boutoirs des lames, qu'à son sommet elle peut
osciller de plusieurs dizaines de centimètres. Que parfois la lanterne,
située pourtant à trente ou quarante mètres du niveau de la mer, est
fracassée par les vagues. Qu'enfin des phares, comme celui d'Eddystone,
au large des côtes anglaises, ont déjà été balayés par la tempête. Les
gardiens ont parfois l'impression de vivre la fin du monde.
« J'ai eu une fois la foudre à Kéréon, raconte
Thomas Le Gall. On était couchés. Le vent venait de l'ouest. Ça cognait
partout. Oh ! Bon Dieu, que je me dis, c'est pas tombé loin. Le coup
d'après, en plein sur le phare. On peut pas imiter ce bruit ; c'est
comme si vous essayez de couper une vitre avec un rasoir. Oh ! ce bruit
formidable ! Ça résonnait dans toute la tour par l'escalier. Alors j'ai
cru que je devenais aveugle. Je suis devenu fou. Je croyais que tout
avait explosé. »
Autant que la tempête ou la foudre, l'isolement en
cas de maladie peut tourner à la catastrophe, surtout en cas de mauvais
temps. « Au phare de la Jument, dit Louis Noret, j'ai un copain qui a eu
une crise d'appendicite. Le docteur (à la radio) m'a dit de mettre de la
glace sur le ventre du malade, mais comme on n'avait plus de viande en
réserve, on avait stoppé le réfrigérateur. Dans le phare, il y avait une
bonne pharmacie et même un bistouri. Car si la vedette n'avait pas pu
emmener le malade, c'est moi qui aurais dû l'opérer. Un médecin m'aurait
guidé par radio. Heureusement, la vedette a pu venir, avec un médecin à
bord. Mais la mer était trop mauvaise, il n'a pas pu monter. On a quand
même pu descendre le collègue et l'emmener à l'hôpital... »
Sur
un câble, dans la tempête...
Ces événements sont cependant exceptionnels. Mais
la relève est un moment dangereux que les gardiens affrontent quatre
fois par mois : les courants et le clapot rendent souvent l'accostage
impossible, les hommes sont obligés de s'asseoir sur un siège, le bouchon,
coulissant sur un câble lui-même fixé d'une part à la
plate-forme du phare, d'autre part au pont de la vedette.
Si tout se passe généralement bien pour
les « montants »excepté un bain glacé de temps à autre l'exercice est nettement plus périlleux pour les « descendants
». Les arrivées brutales sur le pont sont fréquentes, avec leur
lot de foulures, d'entorses et même de fractures.
L'exercice est si impressionnant pour les débutants que l'on dut
un jour descendre, ligoté dans un sac, un jeune stagiaire qui
déclarait préférer mourir sur le phare que se risquer sur le «
bouchon » !
Finalement, de tous les adversaires des gardiens, le plus
redoutable est sans doute l'ennui. Car le travail, qui se résume
à deux quarts de six heures, l'un diurne, l'autre nocturne,
consiste en fait à surveiller des instruments automatiques,
entretenir le phare, à assurer les contacts radio avec la terre,
et à communiquer des informations météorologiques. Ce qui ménage
beaucoup, beaucoup trop d'heures d'oisiveté forcée, que même la
télévision ne saurait combler.
C'est pourquoi les gardiens s'inventent mille et une
occupations : la cuisine, d'abord, qui est pour certains
d'entre-eux une véritable obsession : on passe des heures à
mitonner des petits plats, à inventer des recettes, et l'on
guette les réactions du collègue avec des angoisses de cordon
bleu.
La pêche, ensuite, par atavisme bien-sûr, mais aussi par sens
bien compris de l'économie : ces hommes aux traitements modestes
y trouvent une source gratuite et inépuisable de nourriture
fraîche, de plus bien meilleure pour la santé que les conserves
qu'ils apportent avec eux à chaque relève.
Enfin, le bricolage : du bateau en bouteille traditionnel à la
petite menuiserie, en passant par la marquetterie, la
fabrication d'espadrilles... et même la réparation des vélos,
les gardiens sont en général une providence pour leur famille et
leurs voisins. Beaucoup d'entre-eux trouvent d'ailleurs là un
complément non négligeable à leurs revenus...
Mais que ces activités dérisoires ne nous trompent pas : les
gardiens de phares ne sont pas des figurants à l'utilité
douteuse. Ces solitaires, cloîtrés dans leurs monastères de la
mer, remplissent un rôle essentiel. Sans eux, aucune navigation
ne serait possible. Et si les touristes estivaux l'ignorent
parfois, les marins, eux, le savent bien, et leur vouent un
infini respect (3).
RENÉ GAST
3.: L'auteur de ces lignes vient de
publier, en collaboration avec Jean-Paul Dumontier, un livre
intitulé Des phares et des hommes (Editions Maritimes et
d'outre-mer).
|
|
LES NAUFRAGEURS |
|
Les naufrageurs ont, par un. injuste
paradoxe, toujours plus alimenté la légende de la mer que les
gardiens de phare. Ils sont d'ailleurs aussi anciens qu'eux, et
s'ils ont aujourd'hui disparu, du moins sur nos côtes car il
en existe encore dans certaines régions du monde, ils ont été
dans le passé les fauteurs d'innombrables catastrophes.
Au XIXe siècle encore certaines régions de Bretagne, comme la
côte de Pagans, Ouessant ou Sein comptaient nombre de
naufrageurs fort actifs. Le service des Phares et Balises eut
d'ailleurs à plusieurs reprises maille à partir avec des îliens
qui craignaient qu'un phare ne les prive d'une excellente source
de revenus.
Cette pratique était si habituelle au Moyen Age qu'elle donna
lieu à une abondante législation, et de nombreux seigneurs
tentèrent de réglementer ce sinistre artisanat, non pour le
faire disparaître, mais bien plus tôt pour s'en attribuer le
fruit. Le « droit de bris » qui pendant des siècles conféra au
roi ou à un vassal mandaté le privilège de prendre possession
des épaves échouées sur son territoire, est hérité du temps où
les peuples côtiers exerçaient le naufrage en toute bonne
conscience.
La technique était simple : un brasier allumé sur une falaise ou
un promontoire, un fanal attaché au cou d'une vache ou d'un âne
dont le balancement imitait celui des feux d'un bateau,
attiraient les capitaines des navires égarés dans la tempête. Il
ne restait plus qu'à achever les survivants et à piller
l'épave... |
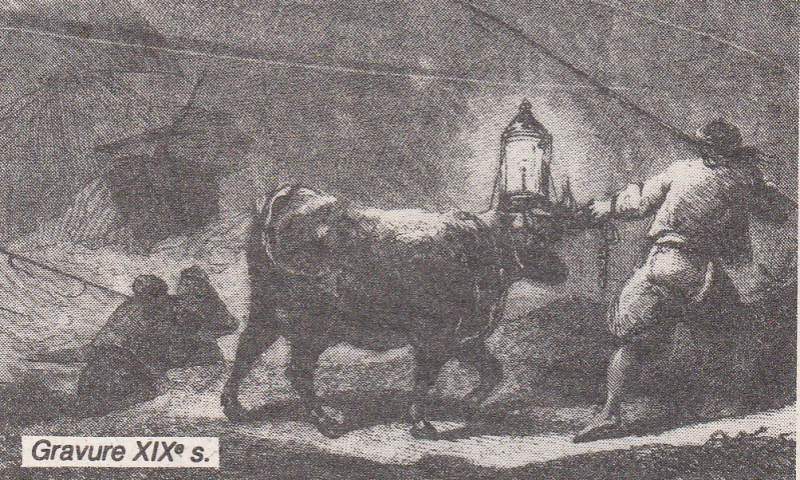 |
1.: Voir
Historia : Quand le phare d'Armen triomphait de la mer, par Louis Le
Cunff, n° 118 ; Le phare allait-il s'écrouler ? par Louis le Cunff, n°
128 ; Terreur sur les phares de Sein, par Louis Le Cunff, n° 272 ; Le
phare d'Alexandrie (les Sept Merveilles du Monde), par G. Buscher, n°
301.
2. : Les Phares par Léon Renard, (Hachette, 1867).
|


